CULTURE
Actus - Débats
Aravind Adiga signe « Le Tigre blanc », premier roman prometteur
 Au fil d’une rentrée littéraire qui a finalement livré une production « bien moyenne », sans chef-d’œuvre aucun, il arrive qu’émergent quelques ouvrages dignes d’un joli « coup de cœur ».
«Le Tigre blanc» d’Aravind Adiga (Buchet-Chastel) est de ceux-là.
Ce roman m’est tombé dessus dans l’univers cosmopolite d’un voyage d’affaires, alors que j’étais entouré de passagers plongés dans la lecture d’articles sur les attentats de Bombay. Dans la fièvre de cette actualité angoissante, loin des images traditionnelles d’une Inde de pacotille, j’ai reçu ce livre comme une assignation.
« Les habitants de ce pays attendent toujours que la guerre de libération vienne d’ailleurs : de la jungle, des montagnes, de Chine, du Pakistan. Cela n’arrivera pas. Chaque homme doit accomplir son propre pèlerinage de libération.
Le livre de ta révolution est dans tes tripes, jeune Indien. Chie-le, et lis. »
Pour un premier roman, Adiga ne prend pas de gants.
Oh, certes, ce n’est pas l’œuvre du siècle. Ce roman souffre d’une construction trop académique, un peu scolaire même. Le récit abuse du mode épistolaire. Un peu facile et trop prévisible. Chaque chapitre correspond à un envoi au Premier Ministre chinois, dont on se demande d’ailleurs ce qu’il vient faire ici, dans tous les sens du terme (géopolitique et romanesque).
Mais si Adiga a obtenu le « Booker Prize » pour ce «Tigre blanc», c’est parce que les libraires d’Outre-manche ont su repérer, dans ce récit biographique, les signes d’un manifeste littéraire dont les Amitav Ghosh (Le pays des marées), les Tarun J. Tejpal (Loin de Chandigarh) plus que Vidiadhar Surajprasad Naipaul ont été les précurseurs. Ici, on est plutôt dans l’univers de Suketu Mehta (Bombay maximum city), mais sans les enluminures esthétiques et les conventions d’une littérature flirtant avec le reportage documentaire.
Maintenant que l’édition occidentale (et notamment anglo-saxonne) a su reconnaître le caractère majeur de la contribution des écrivains indiens et consentir à leurs romans le statut de « nobélisables », la nouvelle génération n’a plus de gage à donner. Elle attaque crûment mais résolument.
Dans l’Inde d’Adiga, la vie commence par la mort. C’est le ferment de sa révolte.
D’abord, la mort de sa mère : «Des bûches…furent empilées sur elle. Après quoi le prêtre mit le feu. Alors que les flammes dévoraient le satin, un pied pâle jaillit comme une chose vivante ; les orteils…se recourbèrent en signe de résistance…Ma mère refusait de se laisser détruire. Sous la plateforme où étaient empilées les bûches…s’accumulait un énorme amas suintant de vase noirâtre…Un chien au pelage pâle maraudait dans les pétales, le satin et les eaux carbonisées…Ma mère essayait de lutter contre la boue opaque…mais la boue l’aspirait, l’aspirait. Bientôt, ma mère se fondrait dans ce magma noir et le chien viendrait la lécher…A ma mort, je suivrai le même chemin. Moi aussi, on me conduirait ici, où rien ni personne ne pouvait trouver la délivrance…Depuis ce jour, je ne suis jamais retourné sur les rives du Gange. Je laisse le fleuve aux touristes américains !».
La mort du père, ensuite : «…Il est tubard…Peut-être que le docteur se pointera ce soir….Le docteur ne vint pas. Vers six heures, ce jour-là, mon père fut définitivement guéri de la tuberculose. Les garçons de salle nous obligèrent à faire le ménage avant de l’emporter. Une chèvre vint renifler son corps pendant que nous lavions le sol souillé avec une serpillière. Les garçons de salle caressèrent la chèvre et lui donnèrent une grosse carotte.»
De son village natal à New Delhi, des bancs d’école à l’emploi à vie (servitude) auprès d’un potentat, de la description des mesquineries locales à celle d’une corruption généralisée, l’auteur écrit son parcours loin des lieux communs sur les rites et les palais de l’Inde. Avec Adiga, la démocratie indienne (« la première démocratie du monde ») est une farce bollywoodienne, avec ses stups, ses stucs et ses stupres, l’hypocrisie du système de castes (il est lui-même de la caste des confiseurs bien que conducteur de rickshaw) et le cynisme des gens de pouvoir.
Adiga n’est ni Darwin, ni Nicolas Bouvier. Il a le regard d’un ethnographe, mais il porte, même si c’est dit avec tendresse parfois, la douleur d’un peuple devenu servile, toujours servile, plus de soixante ans après la révolution nationale.
Les politiques ne trouvent pas grâce à ses yeux : socialisme ? communisme ? Avec humour, il décrypte ce slogan : « Fonds social progressiste all India » (faction léniniste) » et commente ironiquement « C’était le nom du parti des propriétaires !!! ».
La religion ? Un instrument de l’aliénation générale : «Là haut dans le ciel, Dieu étire sa paume sur les plaines, tout en bas, pour montrer au petit homme le village…et tout ce qui s’étend au-delà : un million de villages semblables, un milliard d’individus semblables. Et Dieu demande au petit homme…n’es-tu pas reconnaissant d’être mon serviteur ?» Au fond Adiga préfère le diable qu’il décrit comme le premier des révoltés. «Pour les musulmans, le diable était jadis un acolyte de Dieu qui finit un jour par se fâcher avec lui et se mit à travailler en free lance… Lorsque je songe au diable…j’imagine une petite silhouette noire…je vois le petit homme…cracher vers Dieu encore et encore.»
Mais Adiga n’est pas un violent hérétique. Sa haine est progressive. Elle est intériorisée jusqu’au meurtre final. Et l’auteur nous entraîne subtilement vers son plaidoyer : «Haïssons-nous nos maîtres derrière une façade d’amour, ou les aimons-nous derrière une façade de haine ?».
Sur le maintien des castes, les mariages pré-arrangés, les rapports maîtres-esclaves et aussi sur l’imagerie d’Epinal d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, véhicules de la modernité indienne, Adiga tient l’argument d’un procureur, mais toujours avec ce petit air ironique qui nimbait le cinéma réaliste italien des années 60 («Le Voleur de bicyclette»). Il pose sur son parcours personnel des petits cailloux noirs et entraîne le lecteur dans la partie sombre, puante, d’une économie indienne dont les images, en Occident, continuent à nous parvenir comme des cartes postales post-coloniales, remasterisées au goût d’une croissance à deux chiffres.
L’Inde est un poulailler : «Des centaines de poules blanchâtres et de coqs bariolés…aussi entassés que des airs dans un intestin, se béquettent, se chient dessus et se bousculent pour avoir un peu d’air… Pourtant, ils ne se rebellent pas, ils ne cherchent pas à fuir la cage.»
Plus que dans l’espérance du grand soir auquel il n’a jamais cru, c’est dans l’appel à la vie et le refus sauvage d’une mort préprogrammée qu’Adiga transforme son héros en criminel. Mais la morale, au risque d’être immorale, finit par convaincre le lecteur.
«En résumé, il y avait autrefois mille castes et destins en Inde (1973). De nos jours, il ne reste que deux castes : les gros ventres et les ventres creux. Et deux destins : manger ou être mangé.»
Adiga (son personnage central) a choisi de ne pas être mangé.
Au fil d’une rentrée littéraire qui a finalement livré une production « bien moyenne », sans chef-d’œuvre aucun, il arrive qu’émergent quelques ouvrages dignes d’un joli « coup de cœur ».
«Le Tigre blanc» d’Aravind Adiga (Buchet-Chastel) est de ceux-là.
Ce roman m’est tombé dessus dans l’univers cosmopolite d’un voyage d’affaires, alors que j’étais entouré de passagers plongés dans la lecture d’articles sur les attentats de Bombay. Dans la fièvre de cette actualité angoissante, loin des images traditionnelles d’une Inde de pacotille, j’ai reçu ce livre comme une assignation.
« Les habitants de ce pays attendent toujours que la guerre de libération vienne d’ailleurs : de la jungle, des montagnes, de Chine, du Pakistan. Cela n’arrivera pas. Chaque homme doit accomplir son propre pèlerinage de libération.
Le livre de ta révolution est dans tes tripes, jeune Indien. Chie-le, et lis. »
Pour un premier roman, Adiga ne prend pas de gants.
Oh, certes, ce n’est pas l’œuvre du siècle. Ce roman souffre d’une construction trop académique, un peu scolaire même. Le récit abuse du mode épistolaire. Un peu facile et trop prévisible. Chaque chapitre correspond à un envoi au Premier Ministre chinois, dont on se demande d’ailleurs ce qu’il vient faire ici, dans tous les sens du terme (géopolitique et romanesque).
Mais si Adiga a obtenu le « Booker Prize » pour ce «Tigre blanc», c’est parce que les libraires d’Outre-manche ont su repérer, dans ce récit biographique, les signes d’un manifeste littéraire dont les Amitav Ghosh (Le pays des marées), les Tarun J. Tejpal (Loin de Chandigarh) plus que Vidiadhar Surajprasad Naipaul ont été les précurseurs. Ici, on est plutôt dans l’univers de Suketu Mehta (Bombay maximum city), mais sans les enluminures esthétiques et les conventions d’une littérature flirtant avec le reportage documentaire.
Maintenant que l’édition occidentale (et notamment anglo-saxonne) a su reconnaître le caractère majeur de la contribution des écrivains indiens et consentir à leurs romans le statut de « nobélisables », la nouvelle génération n’a plus de gage à donner. Elle attaque crûment mais résolument.
Dans l’Inde d’Adiga, la vie commence par la mort. C’est le ferment de sa révolte.
D’abord, la mort de sa mère : «Des bûches…furent empilées sur elle. Après quoi le prêtre mit le feu. Alors que les flammes dévoraient le satin, un pied pâle jaillit comme une chose vivante ; les orteils…se recourbèrent en signe de résistance…Ma mère refusait de se laisser détruire. Sous la plateforme où étaient empilées les bûches…s’accumulait un énorme amas suintant de vase noirâtre…Un chien au pelage pâle maraudait dans les pétales, le satin et les eaux carbonisées…Ma mère essayait de lutter contre la boue opaque…mais la boue l’aspirait, l’aspirait. Bientôt, ma mère se fondrait dans ce magma noir et le chien viendrait la lécher…A ma mort, je suivrai le même chemin. Moi aussi, on me conduirait ici, où rien ni personne ne pouvait trouver la délivrance…Depuis ce jour, je ne suis jamais retourné sur les rives du Gange. Je laisse le fleuve aux touristes américains !».
La mort du père, ensuite : «…Il est tubard…Peut-être que le docteur se pointera ce soir….Le docteur ne vint pas. Vers six heures, ce jour-là, mon père fut définitivement guéri de la tuberculose. Les garçons de salle nous obligèrent à faire le ménage avant de l’emporter. Une chèvre vint renifler son corps pendant que nous lavions le sol souillé avec une serpillière. Les garçons de salle caressèrent la chèvre et lui donnèrent une grosse carotte.»
De son village natal à New Delhi, des bancs d’école à l’emploi à vie (servitude) auprès d’un potentat, de la description des mesquineries locales à celle d’une corruption généralisée, l’auteur écrit son parcours loin des lieux communs sur les rites et les palais de l’Inde. Avec Adiga, la démocratie indienne (« la première démocratie du monde ») est une farce bollywoodienne, avec ses stups, ses stucs et ses stupres, l’hypocrisie du système de castes (il est lui-même de la caste des confiseurs bien que conducteur de rickshaw) et le cynisme des gens de pouvoir.
Adiga n’est ni Darwin, ni Nicolas Bouvier. Il a le regard d’un ethnographe, mais il porte, même si c’est dit avec tendresse parfois, la douleur d’un peuple devenu servile, toujours servile, plus de soixante ans après la révolution nationale.
Les politiques ne trouvent pas grâce à ses yeux : socialisme ? communisme ? Avec humour, il décrypte ce slogan : « Fonds social progressiste all India » (faction léniniste) » et commente ironiquement « C’était le nom du parti des propriétaires !!! ».
La religion ? Un instrument de l’aliénation générale : «Là haut dans le ciel, Dieu étire sa paume sur les plaines, tout en bas, pour montrer au petit homme le village…et tout ce qui s’étend au-delà : un million de villages semblables, un milliard d’individus semblables. Et Dieu demande au petit homme…n’es-tu pas reconnaissant d’être mon serviteur ?» Au fond Adiga préfère le diable qu’il décrit comme le premier des révoltés. «Pour les musulmans, le diable était jadis un acolyte de Dieu qui finit un jour par se fâcher avec lui et se mit à travailler en free lance… Lorsque je songe au diable…j’imagine une petite silhouette noire…je vois le petit homme…cracher vers Dieu encore et encore.»
Mais Adiga n’est pas un violent hérétique. Sa haine est progressive. Elle est intériorisée jusqu’au meurtre final. Et l’auteur nous entraîne subtilement vers son plaidoyer : «Haïssons-nous nos maîtres derrière une façade d’amour, ou les aimons-nous derrière une façade de haine ?».
Sur le maintien des castes, les mariages pré-arrangés, les rapports maîtres-esclaves et aussi sur l’imagerie d’Epinal d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, véhicules de la modernité indienne, Adiga tient l’argument d’un procureur, mais toujours avec ce petit air ironique qui nimbait le cinéma réaliste italien des années 60 («Le Voleur de bicyclette»). Il pose sur son parcours personnel des petits cailloux noirs et entraîne le lecteur dans la partie sombre, puante, d’une économie indienne dont les images, en Occident, continuent à nous parvenir comme des cartes postales post-coloniales, remasterisées au goût d’une croissance à deux chiffres.
L’Inde est un poulailler : «Des centaines de poules blanchâtres et de coqs bariolés…aussi entassés que des airs dans un intestin, se béquettent, se chient dessus et se bousculent pour avoir un peu d’air… Pourtant, ils ne se rebellent pas, ils ne cherchent pas à fuir la cage.»
Plus que dans l’espérance du grand soir auquel il n’a jamais cru, c’est dans l’appel à la vie et le refus sauvage d’une mort préprogrammée qu’Adiga transforme son héros en criminel. Mais la morale, au risque d’être immorale, finit par convaincre le lecteur.
«En résumé, il y avait autrefois mille castes et destins en Inde (1973). De nos jours, il ne reste que deux castes : les gros ventres et les ventres creux. Et deux destins : manger ou être mangé.»
Adiga (son personnage central) a choisi de ne pas être mangé.
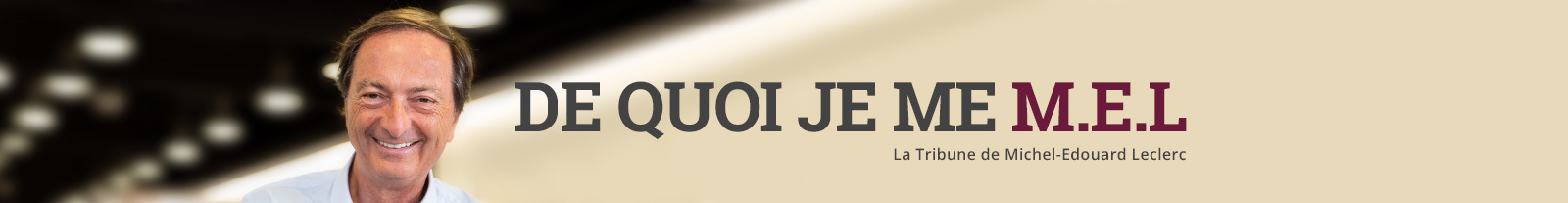





13 Commentaires
Bah moi j'ai choisi mon parti.
J'en reprendrai bien une part!
C'est sympa de nous éclairer sur autre chose que la conso., la bagarre avec les concurrents ou les pouvoirs publiques etc...
Merci MEL pour ce temps de respiration.
Je vais aller voir si je trouve le bouquin à la FNAC... ou dans un espace culturel d'un centre E.Leclerc!
Cela fait déjà quelques temps que l'Inde fait la une au-delà du cercle des intellectuels qui dans les années 70 découvrait le cinéma indien via Satyajit Ray.
En effet de sa croissance économique à Bollywod ou aux récents et épouvantables évènements de Bombay l'Inde est incontournable. Plus on s'y intéressera et plus on va voir qu'il existe, à l'échelle de ce pays, de très nombreux acteurs dans le domaine des arts (tous les arts, littérature, cinéma, etc...)
A l'instar de nos propres auteurs à travers l'histoire littéraire française, il y aura du bon et du moins bon, selon des critères occidentaux d'évaluation techniques des textes ou de la construction romanesque ou plus simplement selon nos goûts.
Je ne connais pas cet auteur et je trouve cela bien que l'on (MEL en l'occurence) puisse nous proposer ce nouveau (pour moi) nom de la littérature indienne.
Quelqu'en soit le contenu, merci pour la démarche.
André
""entraîne le lecteur dans la partie sombre, puante, d’une économie indienne dont les images, en Occident, continuent à nous parvenir comme des cartes postales post-coloniales, remasterisées au goût d’une croissance à deux chiffres.""
se pose la question de la réalité d'une communauté d'un milliard d'individus, alors, entité ou multi provinces en ébullitions pretes a faire secession, pour peu qu'on aille y tenir un discour de type "Quebec libre"....
la durée de vie des "empires" est de moins en moins longue, post colonial dis tu ? croissance a deux chiffres ? c'est une photographie d'un instant "t", que sera demain?
bref toujours sympa tes commentaires sur les bouquins
au fait on lit dans Linéaire, que 8 % de tes adherents sont dans le rouge est ce vrai ?
http://www.editionsduboisbaudry.fr/li/article.php?action=pa&id=41666&PHPSESSID=d88c5eeb7b87f4a5af2890f1430f67b4
@+
expliqué au debut : ce sont des puissances mirroirs et rivales depuis toujours et encore plus aujourd'hui. Le petit Nepal jouant le role d'amortisseur entre les deux nous a peut etre deja preservé d'une 3eme guerre...
BRAVO M.E.LECLERC POUR L'ARNAQUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NEDELEG LAOUEN D'AN HOLL HA BLOAVEZH MAD 2009
*********************************************
Par la même occasion, mon site TRIATHLON Passion est ligne... C'est tout récent...
Parcours d'un TRIATHLETE Finistérien depuis 1986 ...
A découvrir
www.thierryhenri.fr