SOCIÉTÉ
Actus / Débats
Pauvreté : Bob Geldoff, le G-8 et la perspective d’un plan Marshall…
Le contre-sommet d’Edimbourg n’a pas fait recette. A part la manifestation (qui a tout de même mobilisé 200 000 personnes), le forum altermondialiste est peu fréquenté. Et les intervenants sont bien incapables de produire la moindre plate-forme alternative, sauf (ce qui est déjà un bon point) à organiser la pression médiatique sur les chefs d’état réunis pour le G-8.
L’aide aux pays pauvres suscite un formidable élan de solidarité. Mais la limite du mouvement est tout autant culturelle qu’institutionnelle.
- Culturelle :
Les ONG, depuis 10 ans, ont fustigé les états, et surtout les organisations internationales. La donne a changé. Plus personne ne conteste que la mobilisation d’une aide massive passe par l’engagement des états les plus riches et de leurs dirigeants. Hors ce schéma, les interventions, même les plus généreuses, n’auront jamais l’impact suffisant.
- Technique :
Aucun mécanisme de répartition ne s’avère aujourd’hui complètement performant.
L’intérêt des concerts de Geldoff, comme l’intervention de multiples personnalités (Mandela, Tony Blair, Bill Gates ou même Claudia Schiffer), c’est de rallier un maximum de citoyens au soutien de la Cause. Mais on n’échappera pas à ce travail ardu et ingrat : redéfinir une organisation responsable et efficace pour contrôler l’utilisation de l’aide publique.
1) La cause :
Les nations favorisées ne peuvent plus rester aveugles. Dans la seule Afrique, 310 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (moins de 1 dollar par jour). Le continent noir concentre sur son sol toutes les plaies du monde (misère matérielle, déficit éducatif et sanitaire, désertification, endettement, épidémies, dépendance, etc…). L’espérance de vie recule (46 ans !) avec l’accroissement de la mortalité infantile et le sida… Certaines régions d’Amérique Latine ou d’Asie suivent la même pente.
Au rythme actuel d’appauvrissement, les analystes considèrent qu’il faudra attendre le milieu du siècle prochain pour réduire des deux tiers la mortalité des enfants et éradiquer, pour moitié, la pauvreté. Insoutenable !
L’aide extérieure est indispensable. Le continent possède des ressources considérables. Mais la corruption et le détournement des richesses, avec la complicité des élites, voire des nations occidentales, ont gâché les chances de l’Afrique, et probablement aussi les effets d’une partie de l’aide publique déjà accordée.
2) L’aide :
Il y a quinze jours, les 8 nations les plus riches ont annoncé l’annulation de 40 milliards de dollars de dettes concernant 18 des pays les plus pauvres. C’est un premier pas appréciable. Mais dans les comptes de l’ONU, ce sont 53 états africains qui ne bouclent pas leur budget. Et vu l’accroissement des besoins (éducation, santé, infrastructures), les effets de ce ballon d’oxygène seront vite épuisés. Aux Nations Unies, Jeffrey Sachs, coordinateur d’un groupe de réflexion sur le chiffrage des aides, suggère qu’on se fixe un objectif sur 2015. D’après les économistes qui l’entourent, on pourrait diviser par deux le niveau de pauvreté en doublant les contributions actuelles.
Effet de manche ou conviction sincère, Tony Blair propose un plan Marshall de 25 à 50 millions de dollars (sur 3 à 5 ans) pour le continent noir.
Sous la pression des médias et de l’opinion, les chefs d’état semblent aujourd’hui vouloir rivaliser de bonnes intentions. C’est déjà une chose positive.
3) Problématique de la répartition :
Les difficultés sont de trois ordres. Il ne faut pas les minimiser. Si les deux premières dépendent de choix politiques, la troisième est un vrai casse-tête.
a) L’engagement des états :
Dans les sondages, l’opinion publique est toujours généreuse. Devant la feuille d’impôts, elle l’est moins. C’est toute la difficulté des chefs d’état qui, dans un contexte budgétaire difficile, doivent mobiliser des ressources. La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon sont à peu près « carrés ». Ils se sont engagés sur un calendrier. Ce n’est pas le cas des Etats-Unis (qui consacrent moins de 0,16 % de son PIB à l’aide au développement). Ce n’est qu’en partie vrai pour le Japon et la Russie.
b) Les financements :
Plusieurs solutions ont été proposées. Aucune n’a fait l’unanimité : taxe Tobin sur les flux financiers, taxe sur le kérosène et plus généralement le transport aérien, projet anglais de « retour à meilleure fortune » (on financerait des projets rentables qui permettraient d’amortir la dette ? ? ?).
c) Les organismes répartiteurs :
C’est, à mon avis, le problème majeur.
Rien ne garantit qu’après un nouvel élan de générosité, les aides ne finissent dans les sables du désert. Il ne s’agit pas d’évoquer ce problème comme une sorte de caution pour justifier l’inaction. Mais ne l’oublions pas. L’aide au développement est aujourd’hui de 70 milliards de dollars annuels. Jamais elle n’a été aussi élevée. Si elle n’est pas efficace, c’est qu’elle est mal distribuée.
Abdoulaye Wade, Président sénégalais et coordinateur de la dette pour l’Union africaine, s’exprime ce matin dans Libé (04/07). Il propose la création d’une commission mixte : membres du G-8, plus chefs d’état des pays bénéficiaires. Il en appelle à l’esprit de co-responsabilité, et propose la co-gestion des projets par les administrations des 53 états concernés.
Je ne doute pas qu’il trouve là une manière de surmonter l’incapacité des états africains à travailler de manière coordonnée : « L’institution que nous avons mise en place s’avère inopérante. C’est le triste constat ».
Mais pourquoi devrait-on faire confiance à des élites qui, depuis 30 ans, ont fermé les yeux sur la corruption.
A quoi cela servira-t-il de multiplier les sommes versées si les populations africaines restent spoliées du fait de la surenchère confiscatoire que se livrent bourgeoisie nationale et entreprises internationales.
On a posé sur ce blog la question du contrôle et du rythme d’utilisation des fonds pour la reconstruction en Asie (après le tsunami). Les sommes nécessaires et les enjeux pour l’avenir des populations africaines méritent qu’on focalise notre attention sur l’organisation des aides tout autant que sur leur financement.
Saurons-nous ici formuler quelques propositions !
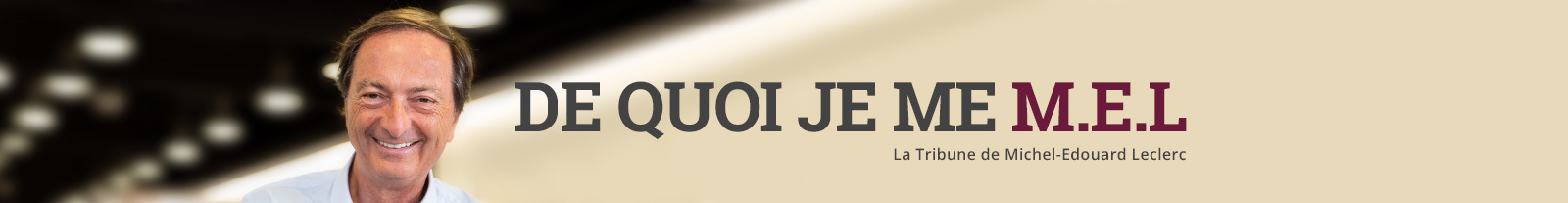





10 Commentaires
un tel sujet ne peut me rester indifférent
vous abordez les limites des ong dans leur tactique contre les états, pour ensuite avouer le role eminent que jouent ces derniers dans la necessaire action envers les pays pauvres. les ong ne peuvent que denoncer les veritables acteurs...en y incluant les multinationales.
le probleme le plus evident est le controle de l'aide dans les pays mêmes.
la corruption est omniprésente et seul un organisme international, type ONU, mais non inféodé aux bourgeoisies locales (comme l'ONICEF par exemple), pourrait jouer ce role si l'on veut aborder des projets de grande ampleur. Mais ne devrait on pas se concentrer sur de multiples petits projets, facilement controlables ?
le commerce équitable remplit cette mission, et les églises rendent un service trop souvent ignoré des médias. les initiatives individuelles sont le plus souvent plus efficaces que les grosse machines étatiques.
fédérons nous autour de projets simples, à échelle humaine, avec des cibles définies...
retroussons nos manches...TOUS
A.
Dans l'attente, pour s'assurer que l'argent arrive bien sur le terrain et non pas dans les comptes suisses des dirigeants, il n'y a qu'une solution : mettre l'Afrique sous tutelle des pays riches.
Ceci peut être légitimement vécu par les Africains comme une nouvelle forme de colonialisme . Aussi il est primordial de monter un organisme de contrôle qui, comme le suggère Abdoulaye Wade, est composé pour au moins moitié d'Africains.
Mais je pense que si cet organisme fonctionne bien, il peut agir au delà de la répartition et commencer à s'intéresser au financement.
Car si on le nanti du pouvoir de mettre à l'amende des entreprises qui pillent le sol Africain et qu'il est soutenu dans sa démarche par tous les états Riches, alors le contribuable Français aura moins à verser en aide directe.
Ainsi si les contrats d'exploitation des TOTAL, EXXON, BP, SHELL et autres étaient passé à la loupe de l'équité, on peut être certain qu'il y aurait beaucoup à redire...
Pour moi, il y a deux axes de réponse :
1 - répondre aux besoins actuels des populations qui sont principalement la faim, la santé et la sécurité ; les 3 étant intimement liés. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'oeuf, lequel faut-il traiter en premier ? Par quoi commencer... Les actions terrains et par micro-projets semblent être les meilleures façons d'aborder les problèmes les uns après les autres ou simultanément ; quoique dans certaines régions (la région des grands lacs notamment), la taille des populations à soutenir fait vite que ces micro-projets deviennent des projets intenables.
Cependant si ces micro-projets (aide à la culture vivrière, assainissement des zones d'habitation, campagnes de vaccination, etc.) sont déjà mis en oeuvre depuis des décennies ; ils sont trop rapidement balayés par des conflits à répétition dans lesquels le rôle des populations est difficile à définir (qui participe? qui trinque sinon les femmes et les enfants?).
On peut aider à combattre la faim et à lutter contre les maladies ... la sécurité est une affaire politique et économique où les ONG et autres bonnes volontés (y compris celle des états occidentaux) ont du mal voire aucune possibilité de s'ingérer... (y ont-elles intérêt d'ailleurs?)
Les périodes de grande peste en Europe étaient souvent couplées avec les périodes de conflit interminables...
Maintenant, comment instaurer la sécurité ? Les états occidentaux ne pourront rien faire sans une volonté forte et acquise des états africains eux-mêmes.
L'Union Africaine et autres organisations régionales doivent être elles-même forces de propositions et de pression pour assainir les relations entre les états (en Afrique Australe, la SADC est en train de faire un travail incroyable pour ouvrir les frontières des pays adhérents cf.SADC Review 2005).
Les décisions sont douloureuses et longues à prendre ou mettre en oeuvre mais elles viennent de l'intérieur avec des modalités propres à leurs modes de fonctionnement et cultures (pas toujours compréhensibles de nous, pauvres petits occidentaux... mais des fois, ça marche...).
Notre aide sur ce plan est alors de les encourager, observer et apporter des financements uniquement sur les projets dont les objectifs sont vérifiables, quantifiables, ... et pas trop éloignés dans le temps... (la notion du temps africain est culturellement différente de la nôtre, gardons-le à l'esprit...).
Financer autrement la sécurité revient à subventionner nos propres industries d'armement.
2 - Voir plus loin, par la formation ... Allez former des ventres vides!! Allez convaincre ces jeunes diplômés porteurs de Masters et de MBA obtenus dans les meilleures universités du Monde occidental qu'il faut qu'ils rentrent chez eux pour colporter la bonne nouvelle...
Mmmmmmouais...
Et pourtant! C'est la clé!
Création d'un centre universitaire panafricain ? Pour garder tous ces cerveaux en Afrique et travailler sur des programmes de formation et de développement proprement africains? Séminaires organisés par l'ONU, la Banque Mondiale, des partenaires privés ciblés sur la jeunesse et traitant de façon non culpabilisante (ben oui à force de s'entendre dire "non, c'est pas comme ça que vous y arriverez" sans pour autant avoir de solution pérenne à leur proposer, on s'enfonce!!)les grands sujets autour du développement africain (tolérance, compréhension, sécurité, respect, compréhension - oui 2 fois, c'est la base - , entrepreneuriat, etc.)?
Les solutions passent par l'ouverture histoire d'oxygéner tous les débats, discussions et propositions. De donner un espoir aux jeunes. Vivre sans espoir (ce qui est le cas aujourd'hui), c'est se condamner.
Désolée, c'est un peu long mais le sujet est complexe ...
une grande partie de la reponse est dans la fomation vous avez raison
mais pas seulement des elites
peut etre des programmes de formations en direction des classes moyennes (commerce, artisanat...) ?
mais qui paye ? qui décide du programme ? des priorités ?
http://entertainment.timesonline.co.uk/article/0,,22209-1677512,00.html
Another very relevant article can also be found here:
http://www.prospectmagazine.co.uk/article_details.php?id=6937
Comme vous avez indiquez controle est tres important mais aussi il faut changer l'esprit des Africains - ils doivent decider ils veulent un futur et les Africans avec les richesses doivent decider de partager et arreter le largesse des annees passes.
Veuillez excusez mon francais - je ne l'ecrit pas souvent.
"L'Afrique participera à ces réunions* debout, unie et solidaire. Il s'agit d'une Afrique responsable qui prend en charge elle-même ses propres problèmes et qui respecte ses principes."
(*note :quelques personnalités africaines sont invitées au sommet du G8 à défendre la position du continent africain au sujet de la dette)
Merci Monsieur Konaré, ça c'est de l'espoir!
En passant, le saviez-vous? C'est moi qui écris ses discours ;-) ... Bon je blague .... Mais je n'en étais pas loin dans mes propositions ...
- soit ils ne font rien et on les accuse d'indifférence ;
- soit ils essaient de faire quelque chose et on les taxe de néocolonialisme.
Pour éviter ces deux écueils, on multiplie l'aide tout en laissant le soin aux Etats destinataires de la gérer.
Aujourd'hui, on voit bien que cela ne marche pas : on enrichit des élites au détriment des plus nécessiteux.
Comme vous le pointez justement, ce qui importe c'est de s'assurer que les aides vont bien à ceux qui en ont besoin.
Comment faire ?
La proposition de Wade, si elle peut paraître lourde au début, me semble la plus adéquate sur le long terme :
- il faut que les pays donateurs puissent s'assurer de la bonne utilisation de ces fonds ;
- il faut que les pays destinataires soient impliqués dans le processus.
Il est indispensable, me semble-t-il, qu'un mécanisme de sanction soit applicable pour les pays qui n'apporteraient pas des preuves de la bonne utilisation des fonds.
Mais, il est vrai, qu'au-delà des évènements ponctuels auxquels on ne peut qu'adhérer, il faut travailler à la définition des mécanismes de distribution.
Encore une fois, le diable est dans les détails.
- budget et contribution solidaire aux ressources de l'UA : 5 pays contribuent pour 75% aux revenus de l'UA (Lybie, Afrique du Sud, Algérie, Nigéria, Egypte), les 48 autres s'assoient et regardent ... comment voulez-vous qu'ils se sentent impliqués?
- les projets et programmes de l'UA sont évalués à 350 millions USD alors que ses ressources à juillet 2005 s'élèvent à seulement 25 millions USD...on peut rapidement imaginer où passe l'argent...
(sources : Jeune Afrique l'intelligent)
De vos contributions, je retiens quelques idées phares :
1) Il faut associer les Africains eux-mêmes à la définition des besoins, et les responsabiliser. Cela passe par la présence des états africains dans l’organisme international chargé de la coordination des aides, ou l’obligation des états receveurs (dans le cadre de relations bilatérales) de se soumettre à des contrôles plus précis.
2) Peut-on raisonnablement compter sur les seuls états ? Vu la corruption des élites, ou les conflits interethniques jusque dans les systèmes de représentation, on peut en douter. Sébastien évoque un mécanisme de sanctions. Mais que peuvent-elles être ? Et si elles existent, ne conduisent-elles pas encore plus à la privation des populations ?
3) Devant la difficulté de maîtriser les très gros projets, il me semble que Florence Jean a plutôt raison de préconiser les financements de micro-réalisations (objectifs vérifiables, quantifiables, proximité des décideurs et des utilisateurs).
4) Faut-il encore avoir des complexes et avoir peur de se faire taxer de néo-colonialisme ? Personnellement, je ne le pense pas. Je crois aux vertus du parrainage (un pays donateur, un pays destinataire ; une entreprise acheteuse, un groupement de producteurs dans le pays pauvre ; jumelage entre régions, écoles, universités et entreprises…). Je sais, ça fait un peu scout. Mais c’est une bonne manière d’impliquer tous les opérateurs (riches ou pauvres) sur un projet.
Continuons cette réflexion…