ÉCONOMIE
Actus / Débats
La baisse des prix : une affaire politique
Pour la deuxième année consécutive, mon enseigne lance une campagne pour obtenir le droit de baisser les prix. Pour commencer : trois affiches, placardées sur les murs de France et dans la presse, et dont le graphisme pop art s’inspire des créations de l’Atelier des Beaux-Arts en 1968. A gauche comme à droite, les vieux guerriers ont salué avec humour le clin d’œil. Seuls quelques grincheux ont crié au détournement d’héritage. Le Premier Ministre, lui n’a pas aimé. Surtout l’affiche avec le CRS. Il trouve que c’est un appel à la violence au moment où les lycéens justement se retrouvent dans la rue. Je ne veux pas polémiquer avec lui; même si franchement son propos est excessif à notre égard. Il ne le sait peut-être pas, mais j’ai une réelle estime pour lui. Sa tâche est immensément difficile, surtout que pour réformer la Loi Galland (ma cible), il a contre lui une partie de son camp.
Pour autant, je ne vais pas le contredire. La matraque, sur l’affiche, c’est bien un symbole violent : celui des prélèvements obligatoires et des hausses de prix qui s’abattent sur le pouvoir d’achat des Français. Il a raison, ça fait mal au portefeuille...
Je l’avoue aussi : avec cette campagne, je poursuis un but politique. Je veux inciter le gouvernement et les parlementaires à tenir compte des attentes populaires. Pas question de se laisser enfermer dans l’élaboration d’un compromis interprofessionnel, négocié au final dans l’antichambre d’un ministère. Il nous faut une réforme qui laisse profiter les consommateurs d’un vrai retour à la concurrence.
Je comprends que les opposants à la baisse des prix prennent ombrage de notre campagne. Mais pourquoi celui qui veut « lutter contre la vie chère » cherche-t-il à se priver par avance d’une action populaire, en dénigrant l’un de ses meilleurs alliés (les centres E.Leclerc) dans la lutte contre l’inflation ? Voilà qui laisse planer bien des doutes sur la réalité de ses intentions !


 La presse économique mondiale a repris sans recul, ni remarque critique, l'argument « proforma » conçu par les RP des deux protagonistes : « Si fusion il y a, c'est qu'elle est rendue nécessaire par la concentration croissante de l'appareil de distribution. L'expansion des Wall-Mart Carrefour, Tesco, Metro, à l'échelle mondiale, justifie ces rapprochements. » Et dans toutes les pages roses que consacrent à l'économie les gazettes occidentales, on nous annonce d'autres fusions ou acquisitions pour faire pendant aux ambitions impériales des épiciers planétaires.
L'argument est faux. Il n'a qu'un mérite : parer à l'avance les critiques des organisations anti-trusts qui pourraient légitimement s'inquiéter de la construction de tels oligopoles. Dans les hypers, les trois leaders que sont Procter/Gillette, L'Oréal et Unilever, fournissent à 80-90% l'offre en linéaires (couches, rasoirs, colorants et shampoings). Toute fusion dans ce secteur ne fait mécaniquement que renforcer ce leadership.
Alors, contrepoids de la distribution ? De qui se moque-t-on ? L'un de mes proches collaborateurs qui a fait ses classes chez Unilever avant de rejoindre notre enseigne, me rappelait récemment ce morceau d'histoire industrielle : en 1929, les dirigeants de Lever Brothers Limited avaient invoqué les synergies entre les savonneries éponymes et la Société Margarine Unie de Rotterdam pour justifier la naissance du mastodonte Unilever. A l'époque, la distribution, c'était quelques grands magasins, et surtout des milliers d'épiceries. Mais Sam Walton (fondateur de Wall Mart) avait 11 ans et Edouard Leclerc, mon père, 3 ans. La distribution moderne n'était pas née que l'industrie des biens de consommation se concentrait déjà.
Comme le pressent Stéphane Lauer (Le Monde, 12/02), ces mouvements financiers ont donc moins pour objectif de « rééquilibrer les rapports de puissance industrie/commerce » que de prendre des parts de marché aux autres industriels. Il s'agit de tuer la concurrence et de conforter le leadership des marques de quelques groupes mondiaux. Ceux-ci dépensent des sommes énormes en marketing, en publicité, en budgets de coopération commerciale, avec pour conséquence, la marginalisation de leurs challengers, voire leur éviction. Ce sont encore ces mêmes groupes qui imposent les fameux accords de gamme obligeant les distributeurs à détenir un énorme assortiment pour pouvoir bien acheter les quelques références incontournables.
On peut comprendre la motivation financière : il s'agit de générer des économies d'échelle et permettent de concentrer toute la force de frappe sur vingt ou trente marques leaders désormais mondialisées. On peut néanmoins s'interroger sur l'intérêt commercial à long terme d'une telle opération. Les dirigeants de ces trusts ne font même pas mystère de leur intentio : une fois la part de marché renforcée, ils supprimeront, dans leur propre portefeuille de marques, toutes celles qu'ils jugeront secondaires. Il en résultera forcément un appauvrissement de l'offre.
Voilà les distributeurs confortés dans la nécessité de développer leurs marques propres. Les grandes marques, il faut les avoir en rayon ! Impossible de ne pas les référencer, elles sont « pré-vendues » par le matraquage publicitaire. Mais les distributeurs n'ayant plus aucun pouvoir sur les marges et sur les prix de vente, il leur faut trouver un levier de négociation et un complément de gamme. Seules les marques génériques peuvent offrir cette marge de manoeuvre. Même l'offre des PME, dans ce paysage, s'en trouve trop fragilisée pour constituer une véritable alternative.
Je suis prêt à prendre les paris. Cette course à la taille, dans la distribution comme dans l'industrie, peut tarir le dynamisme du marché. Un régime de concurrence contribue à la diversité et à l'animation de l'offre. L'oligopole pousse à la standardisation de l'offre, à sa banalisation et finit par créer l'atonie de la consommation.
A suivre...
La presse économique mondiale a repris sans recul, ni remarque critique, l'argument « proforma » conçu par les RP des deux protagonistes : « Si fusion il y a, c'est qu'elle est rendue nécessaire par la concentration croissante de l'appareil de distribution. L'expansion des Wall-Mart Carrefour, Tesco, Metro, à l'échelle mondiale, justifie ces rapprochements. » Et dans toutes les pages roses que consacrent à l'économie les gazettes occidentales, on nous annonce d'autres fusions ou acquisitions pour faire pendant aux ambitions impériales des épiciers planétaires.
L'argument est faux. Il n'a qu'un mérite : parer à l'avance les critiques des organisations anti-trusts qui pourraient légitimement s'inquiéter de la construction de tels oligopoles. Dans les hypers, les trois leaders que sont Procter/Gillette, L'Oréal et Unilever, fournissent à 80-90% l'offre en linéaires (couches, rasoirs, colorants et shampoings). Toute fusion dans ce secteur ne fait mécaniquement que renforcer ce leadership.
Alors, contrepoids de la distribution ? De qui se moque-t-on ? L'un de mes proches collaborateurs qui a fait ses classes chez Unilever avant de rejoindre notre enseigne, me rappelait récemment ce morceau d'histoire industrielle : en 1929, les dirigeants de Lever Brothers Limited avaient invoqué les synergies entre les savonneries éponymes et la Société Margarine Unie de Rotterdam pour justifier la naissance du mastodonte Unilever. A l'époque, la distribution, c'était quelques grands magasins, et surtout des milliers d'épiceries. Mais Sam Walton (fondateur de Wall Mart) avait 11 ans et Edouard Leclerc, mon père, 3 ans. La distribution moderne n'était pas née que l'industrie des biens de consommation se concentrait déjà.
Comme le pressent Stéphane Lauer (Le Monde, 12/02), ces mouvements financiers ont donc moins pour objectif de « rééquilibrer les rapports de puissance industrie/commerce » que de prendre des parts de marché aux autres industriels. Il s'agit de tuer la concurrence et de conforter le leadership des marques de quelques groupes mondiaux. Ceux-ci dépensent des sommes énormes en marketing, en publicité, en budgets de coopération commerciale, avec pour conséquence, la marginalisation de leurs challengers, voire leur éviction. Ce sont encore ces mêmes groupes qui imposent les fameux accords de gamme obligeant les distributeurs à détenir un énorme assortiment pour pouvoir bien acheter les quelques références incontournables.
On peut comprendre la motivation financière : il s'agit de générer des économies d'échelle et permettent de concentrer toute la force de frappe sur vingt ou trente marques leaders désormais mondialisées. On peut néanmoins s'interroger sur l'intérêt commercial à long terme d'une telle opération. Les dirigeants de ces trusts ne font même pas mystère de leur intentio : une fois la part de marché renforcée, ils supprimeront, dans leur propre portefeuille de marques, toutes celles qu'ils jugeront secondaires. Il en résultera forcément un appauvrissement de l'offre.
Voilà les distributeurs confortés dans la nécessité de développer leurs marques propres. Les grandes marques, il faut les avoir en rayon ! Impossible de ne pas les référencer, elles sont « pré-vendues » par le matraquage publicitaire. Mais les distributeurs n'ayant plus aucun pouvoir sur les marges et sur les prix de vente, il leur faut trouver un levier de négociation et un complément de gamme. Seules les marques génériques peuvent offrir cette marge de manoeuvre. Même l'offre des PME, dans ce paysage, s'en trouve trop fragilisée pour constituer une véritable alternative.
Je suis prêt à prendre les paris. Cette course à la taille, dans la distribution comme dans l'industrie, peut tarir le dynamisme du marché. Un régime de concurrence contribue à la diversité et à l'animation de l'offre. L'oligopole pousse à la standardisation de l'offre, à sa banalisation et finit par créer l'atonie de la consommation.
A suivre...
 |
ECONOMIE : Fusion Procter - Gillette, la loi du plus fort |
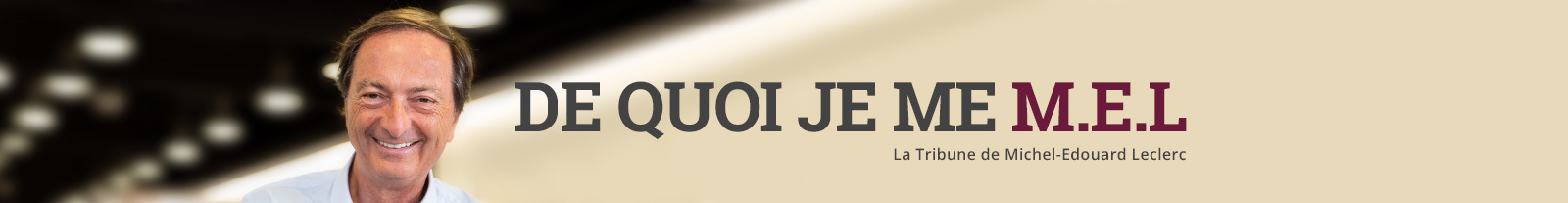



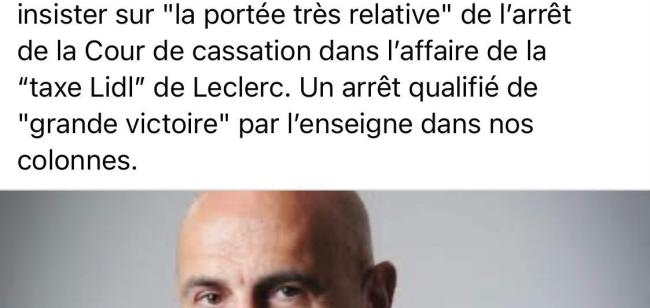

0 Commentaires